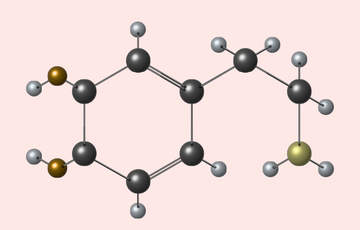Quand les terreurs nocturnes frappent à l'âge adulte
Publié il y a 7 mois
17.07.2025
Partager

4 heures du matin. Anna* se réveille dans un lieu qui lui semble inconnu. Elle sent une présence et hurle. Les secondes, ou peut-être les minutes, passent. Après ce moment, le contour des formes obscures autour d’elle se fait plus net. Son rythme cardiaque redescend et elle comprend que tout ce temps, elle se trouvait dans le confort de sa chambre. «Je ne savais pas où j'étais. Comme si, une fois réveillée, je continuais mon cauchemar.»
Ce n’est pas la première fois que la trentenaire vit un épisode de «terreur nocturne», un phénomène bien connu chez les enfants, mais moins documenté chez les adultes, pourtant aussi concernés. Geoffroy Solelhac est médecin associé au Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil au CHUV et confirme: «Dans ma consultation, je vois souvent des jeunes adultes. Il arrive ainsi que les terreurs nocturnes persistent après l’enfance».
Les terreurs nocturnes font partie des parasomnies, soit des troubles du comportement au cours du sommeil. Dans cette catégorie, on retrouve le somnambulisme ou encore la paralysie du sommeil. «Il peut arriver qu'une personne concernée par les terreurs nocturnes souffre d'autres parasomnies», explique Geoffroy Solelhac.
Les formes que peuvent prendre ce type de terreurs varient d'une personne à l’autre. Barbara, la trentaine également, explique en avoir depuis une dizaine d’années. Pour elle, c'est à chaque fois le même scénario: elle se réveille dans un état d'angoisse et croit apercevoir, au fond de la pièce, une silhouette d'homme. «Ce n'est pas évident d'en parler à mon entourage. Les gens ne comprennent pas, ou pensent parfois que j'ai un problème. Il faut dire que c'est impressionnant de se réveiller en criant à pleins poumons. On m'a même expliqué qu'il m'est arrivé de parler dans cet état de réveil où je ne suis pourtant pas consciente.»

«Le contexte de vie compte, si l'individu est stressé, anxieux, s'il manque de sommeil ou alors s'il doit dormir dans un environnement bruyant ou trop chaud: tout cela favorise la survenue de terreurs nocturnes», explique Geoffroy Solelhac, médecin associé au centre d'investigation et de recherche sur le sommeil au CHUV.
Différent du cauchemar
La confusion entre cauchemar et terreur nocturne est fréquente, mais elle est trompeuse. «Un cauchemar, on s’en souvient. On est conscient et orienté au moment du réveil, précise Geoffroy Solelhac, tandis que lors d’une terreur nocturne, la personne est dans un état entre la veille et le sommeil. Elle vit une scène d’angoisse, parfois extrême, sans pouvoir la contrôler. Elle peut ressentir une peur intense, avoir des hallucinations visuelles, comme un plafond qui tombe ou des insectes. Souvent, elle ne garde aucun souvenir clair de l’épisode.»
Anna a d’ailleurs déjà vécu une scène marquante: «Je dormais chez ma belle-famille avec mon compagnon, quand je me suis réveillée en hurlant, sans réussir à comprendre où j’étais. Le lendemain, j’étais gênée, je ne savais pas comment expliquer mes cris.»
Il existe bien un terrain génétique qui justifie les terreurs nocturnes. «On voit des cas de parasomnies chez les frères, sœurs ou parents, mais on n’a pas trouvé le gène responsable», commente Geoffroy Solelhac. Au-delà des facteurs innés, l’environnement dans lequel se trouve la personne souffrant de ce genre de parasomnie joue un rôle, insiste le spécialiste. «Le contexte de vie compte, si l’individu est stressé, anxieux, s’il manque de sommeil ou alors s’il doit dormir dans un endroit bruyant ou trop chaud: tout cela favorise la survenue de terreurs nocturnes».
Une analyse précise grâce à la polysomnographie
La détection des terreurs nocturnes repose avant tout sur une évaluation clinique. Dans de rares cas, une polysomnographie, soit un enregistrement complet du sommeil, peut être réalisée à l’hôpital ou à domicile pour affiner l’analyse. La prise en charge repose cependant majoritairement sur des approches non médicamenteuses. «On privilégie aujourd’hui les thérapies douces, comme l’hypnose médicale ou l’éducation thérapeutique, qui a montré des résultats prometteurs dans les parasomnies du sommeil lent», explique le docteur.
Lorsque les terreurs nocturnes s’accompagnent de somnambulisme, il existe certains risques. «La personne peut se lever brusquement, se cogner contre des meubles ou ouvrir une fenêtre, ce qui l’expose à des blessures accidentelles.» Toutefois, les terreurs nocturnes ne sont pas inquiétantes en soi. «Rien ne prouve qu’il existe un lien direct entre les parasomnies et d’éventuels troubles psychiatriques ou neurologiques, rassure le spécialiste. Si cela perturbe le sommeil ou entraîne une grande fatigue, il faut consulter. Mais si la personne vit bien sa situation, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.»
Pour Anna, aborder la question avec un spécialiste l’a aidée. «Parler des terreurs nocturnes à mon psychologue m’a sortie d’un certain isolement. Quand elles sont très présentes, je sais maintenant que ça reflète une période plus anxieuse pour moi.» Son témoignage fait écho à ce qu’observe le spécialiste sur le terrain. «Il est vrai que les terreurs nocturnes touchent beaucoup de jeunes adultes. Elles sont souvent plus intenses à un moment de transition, comme lors d’un nouvel emploi, d’une rupture ou d’une période d’examens.»
Le sommeil, une affaire très personnelle
Selon une étude américaine, vouloir optimiser son sommeil à tout prix pourrait paradoxalement le détériorer. Sur le marché, les moniteurs de sommeil sont nombreux, et prennent des formes multiples: bagues, bracelets, montres connectées. Reste que ces technologies peuvent engendrer une forme d’anxiété liée à l’idée de ne pas réussir à passer une nuit parfaite. «Les données fournies par ces objets peuvent devenir une source de stress inutile alors qu’elles ne disent pas grand-chose, analyse Geoffroy Solelhac. Elles font croire qu’il existe un standard du sommeil universel, alors qu’il varie d’une personne à l’autre. Si on n’a pas de trouble de sommeil, ce n’est pas utile. Et si on en a, cela peut les aggraver.»
*Prénom d'emprunt