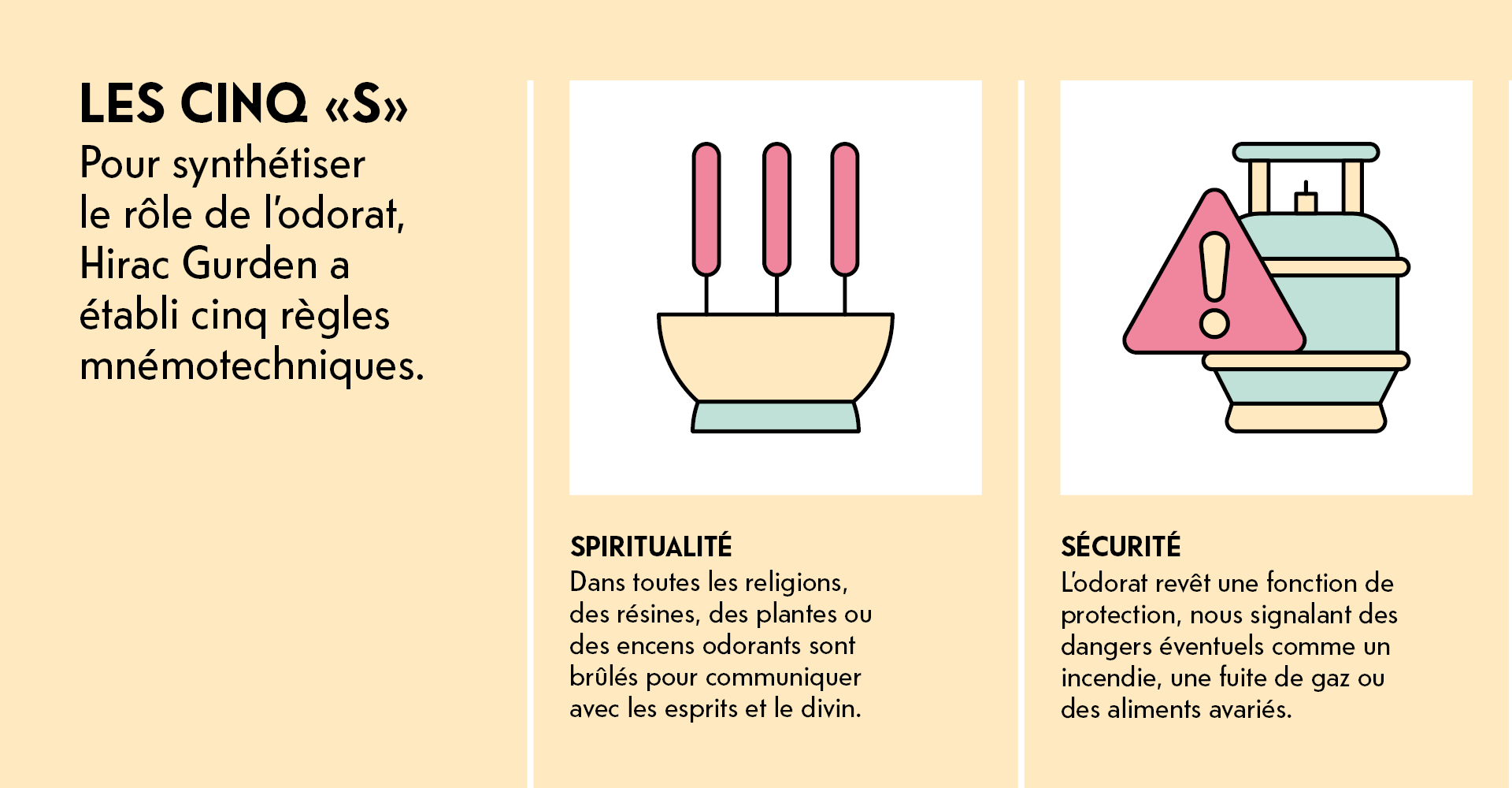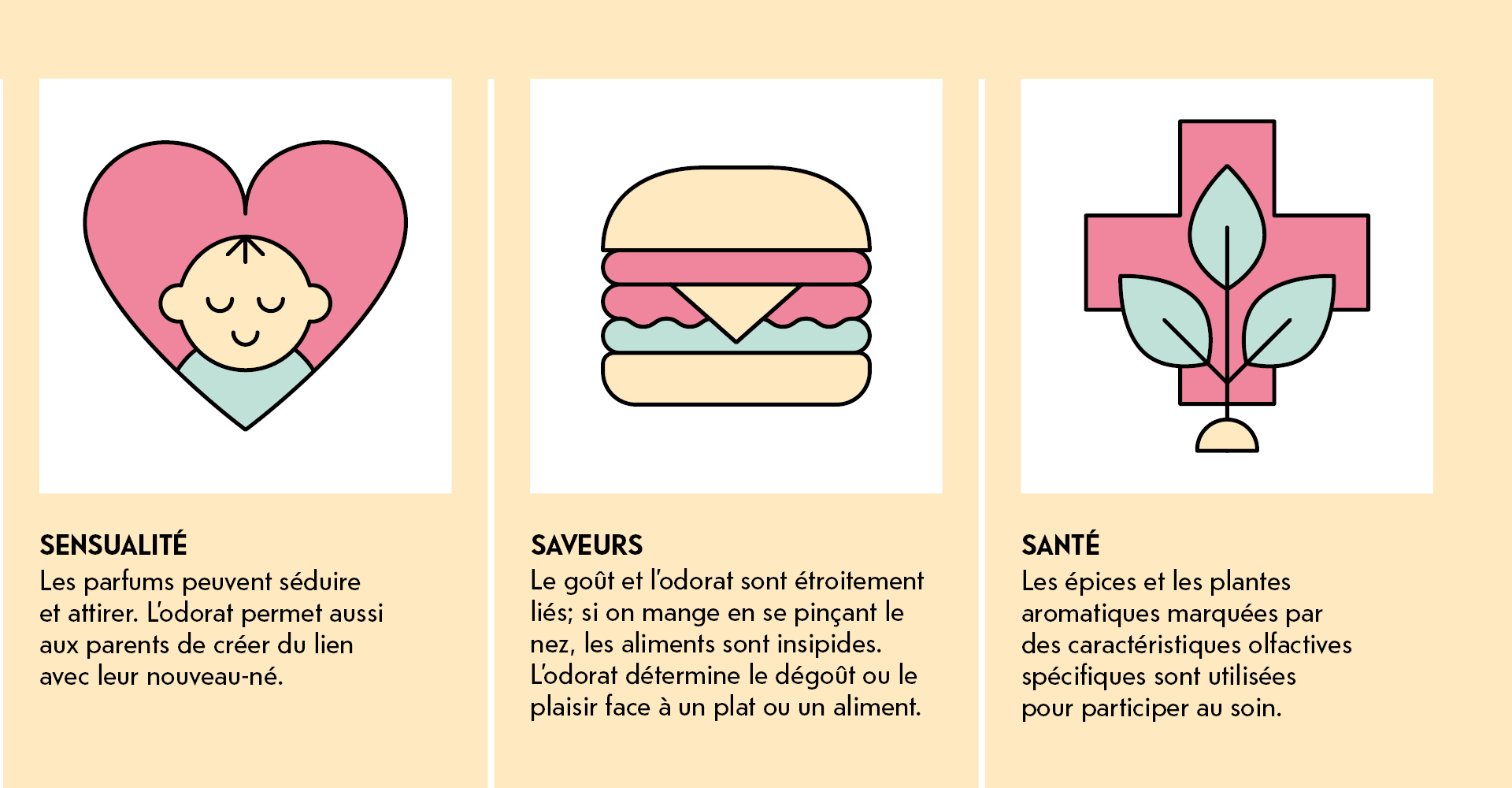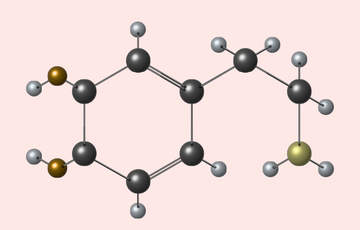L'ODORAT, OUTIL DE DIAGNOSTIC
Publié il y a 1 an
06.01.2025
Partager

IN VIVO Comment les informations olfactives guident-elles nos comportements?
HIRAC GURDEN Notre système cérébral de détection des odeurs fonctionne en permanence. Les émotions et la mémoire sont constamment stimulées par l’odorat. Ce sens a une fonction au niveau du système hédonique (du plaisir). Grâce à lui, nous pouvons apprécier un plat savoureux ou déguster un bon vin. Il a aussi un rôle d’alerte: il nous permet de réagir de manière adéquate si nous détectons l’odeur de brûlé, par exemple. Les odeurs nous accompagnent partout, tous les jours, toute notre vie; dans la cuisine, en forêt, dans les transports en commun, ou encore sur notre propre corps.
IV En quoi consiste la «signature olfactive»?
HG Tous les êtres vivants libèrent des odeurs, dégagées par l’haleine, les cheveux, la peau et les orifices corporels. Cette «signature olfactive» qui nous caractérise est comme une empreinte digitale, riche d’informations pour nous et les autres. Elle change en fonction de l’alimentation, des émotions fortes ou de l’âge et la variation du métabolisme. L’odeur dans une classe maternelle est différente de celle d’une chambre d’adolescent-e ou d’une maison de retraite. Les molécules odorantes corporelles peuvent induire des réactions innées et automatiques – de joie ou de dégoût – chez autrui.
IV La signature olfactive permet aussi de détecter des maladies?
HG Oui, car elle est également influencée par notre état de santé. Des cellules tumorales, par exemple, dégagent une odeur particulière. À l’avenir, la signature olfactive s’ajoutera à d’autres paramètres – comme les analyses sanguines ou de l’urine – pour poser un diagnostic de maladie. D’ailleurs, des programmes de dressage de chiens sont en place pour détecter plusieurs pathologies par la reconnaissance olfactive. Des solutions électroniques sont également en voie d’élaboration dans le même but.
IV Tenir compte des informations olfactives pour évaluer l’état de santé n’est pas une nouveauté?
HG En effet, dans l’Antiquité, on savait, par exemple, que l’haleine des diabétiques avait une odeur d’acétone, soit de pomme un peu pourrie. Avicenne, un médecin perse du Xe-XIe siècle, proposait de sentir les urines et les odeurs corporelles pour déterminer des pathologies. Dans la médecine ayurvédique, dont les origines remontent à plus de 5000 ans, on prêtait déjà attention aux odeurs du corps pour détecter des maladies.
LE FONCTIONNEMENT DE L'ODORAT
Ce sens implique des structures spécialisées localisées dans le nez et le cerveau. Différents facteurs peuvent limiter les capacités olfactives.
«Les odeurs proviennent de molécules chimiques présentes dans l’air qui entrent dans les fosses nasales quand on respire, puis atteignent la muqueuse olfactive localisée dans la partie supérieure des cavités nasales. C’est là que se trouvent les récepteurs olfactifs», explique Antoine Reinhard, responsable de l’unité de rhinologie du CHUV. Quand la molécule odorante se fixe sur le récepteur, cette interaction induit un signal électrique qui, via les neurones olfactifs, est transmis au cerveau. Ces informations sont traitées, puis envoyées à différentes régions du cerveau. Notamment au cortex olfactif primaire, qui identifie et différencie les odeurs, et au système limbique qui va associer les odeurs à des émotions et à des souvenirs. Naturellement, en vieillissant, l’odorat diminue. 20% des personnes âgées de plus de 60 ans ont des troubles de l’odorat et ceux-ci augmentent avec l’âge, avance l’expert. «Sans odorat, on a moins envie de manger, on peut subir une perte pondérale ou avoir des troubles alimentaires. On peut aussi devenir dépressif car on perd les plaisirs de l’odorat ou plus anxieux parce que la fonction d’alerte de l’odorat est altérée.»