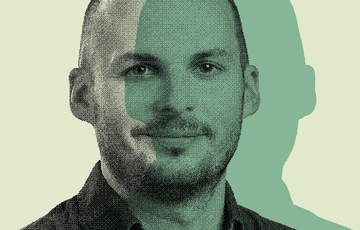UNE CÉSARIENNE MOINS CHIRURGICALE
Publié il y a 1 an
12.12.2024
Partager
«C’était magnifique, cette césarienne m’a consolée de ne pas avoir pu accoucher par voie basse.» Dima, 38 ans, a vécu trois césariennes. Pour son dernier enfant né il y a deux ans, elle a pu être l’une des premières patientes à bénéficier d’une césarienne participative au CHUV. «Mon premier enfant est né par césarienne d’urgence. J’ai eu l’impression d’être charcutée et que l’on avait arraché le bébé de mon ventre. C’était très violent», raconte-t-elle. Lors de sa deuxième césarienne, programmée cette fois, elle a été séparée de son nouveau-né pendant trois heures. Sa troisième césarienne s’est déroulée tout à fait différemment. «C’était d’une telle douceur, cela m’a réconciliée avec les naissances précédentes», raconte Dima.
L'IMPORTANCE DE L'AMBIANCE
Il arrive que durant la grossesse, des complications empêchent l’accouchement par voie basse qui mettrait en danger la mère ou l’enfant. L’annonce d’une césarienne est souvent vécue comme une déception par les futures mères qui doivent parfois renoncer à l’idée qu’elles se faisaient de leur accouchement. Lorsque la césarienne ne doit pas être pratiquée d’urgence, au moment de l’accouchement, il est possible d’envisager une césarienne participative. Cette pratique répond à un besoin de réappropriation de l’expérience de naissance, la transformant en un moment plus intime et humain.
«Nous essayons de recréer une atmosphère de salle d’accouchement pour mettre davantage le focus sur le fait de donner naissance que de subir une intervention chirurgicale»
La césarienne participative reste un acte chirurgical qui a lieu dans un bloc opératoire sous anesthésie locale. Mais une série d’ajustements permet une expérience complètement différente pour les familles. «Nous essayons de recréer une atmosphère de salle d’accouchement pour mettre davantage le focus sur le fait de donner naissance à un enfant que de subir une intervention chirurgicale», explique la Hélène Legardeur, médecin gynécologue obstétricienne au CHUV.
LES ÉTAPES DE LA CÉSARIENNE PARTICIPATIVE
Le jour de l’accouchement, la patiente se rend à pied au bloc opératoire, accompagnée de son ou sa partenaire qui sera présent-e tout le long, contrairement à une césarienne classique où la présence du co-parent est limitée. Durant l’intervention, la lumière est tamisée, la future maman peut écouter la musique de son choix et le drap opaque habituel est remplacé par une toile transparente qui permet à la mère de voir son bébé à l’instant où il naît. Les femmes qui le souhaitent peuvent même pousser, comme lors d’un accouchement par voie basse, pour accompagner la sortie de l’enfant.
Après la naissance, un moment clé de la césarienne participative est la pratique du peau-à-peau immédiat entre la mère et le bébé, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. «On sait que le peau-à-peau continu pendant une heure permet au bébé de mieux réguler sa température, de favoriser le lien avec la mère et la mise en place de l’allaitement. Mais c’est un vrai défi en césarienne parce qu’il y a des risques de malaises chez l’enfant qui exigent une surveillance constante, ce qui est compliqué en bloc opératoire. Nous avons donc dû innover», reconnaît Hélène Legardeur.

Pour rendre le peau-à-peau possible, les électrodes permettant de monitorer la mère sont placées dans son dos afin de faciliter ses mouvements. La saturation en oxygène du bébé est suivie à distance, en dehors de la pièce, pour conserver l’atmosphère intime du moment. Enfin, un bandeau est placé sur la poitrine de la patiente pour y accueillir le nouveau-né et le maintenir en sécurité. La mère et l’enfant peuvent ainsi être déplacés ensemble de la table d’opération au lit.
Ces adaptations sont le fruit d’un travail d’équipe entre les obstétricien-nes, les anesthésistes, les sage-femmes, les infirmiers et infirmières et le personnel technique où chacun-e a dû repenser sa pratique. «Chaque profession a ses impératifs qu’il faut respecter. Nous avons pu trouver des compromis sans qu’il y ait d’impact sur la sécurité et la stérilité du bloc opératoire. Par exemple, la température de la salle est augmentée de quelques degrés pour le bien-être de la patiente et du bébé, mais cet ajustement n’a pas d’impact sur le risque d’infection. C’est juste un peu moins confortable pour les médecins», précise Alexia Cuenoud, médecin anesthésiste au CHUV.
LE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
À une époque où les violences obstétricales sont très médiatisées, ces changements s’inscrivent également dans une remise en question plus large des pratiques en gynécologie. «Il y a une prise de conscience de la nécessité d’améliorer l’information aux patientes. Dans une césarienne participative, on leur demande d’être parties prenantes, c’est très nouveau. Cela s’appelle le consentement éclairé. La patiente doit savoir ce qui va lui arriver afin de l’accepter ou non. L’intervention repose sur la co-décision», souligne Hélène Legardeur.
Pour les familles, le changement est immense. Les premiers retours sur la satisfaction des parents sont très positifs. Les bénéfices sur la santé de la mère et de l’enfant sont également importants, notamment grâce au principe de réhabilitation précoce (lire l’encadré). Pour Dima qui a pu le vivre, cela ne fait aucun doute. «Je me suis sentie plus en forme physiquement après la césarienne participative. Même si j’ai eu mal, il n’y a pas eu de douleur psychique et je suis en paix avec cette césarienne.»
UNE MEILLEURE RÉCUPÉRATION
L’une des difficultés de la césarienne est sa convalescence, plus longue que pour un accouchement vaginal, notamment en raison du temps de cicatrisation. La césarienne participative telle que pratiquée au CHUV est aussi associée à un concept de récupération précoce. Le but est de minimiser l’impact de la chirurgie afin que la mère soit mobile le plus rapidement possible tout en limitant la douleur, un aspect d’autant plus important quand il faut prendre soin d’un nouveau-né. «Il s’agit d’améliorer la participation du couple à un projet de naissance. La littérature scientifique montre que plus les patientes sont en mesure de se lever rapidement après l’intervention, plus le lien avec l’enfant est favorisé et moins il y a de dépressions du post-partum», observe la Hélène Legardeur, médecin gynécologue obstétricienne au CHUV. La mobilisation rapide, associée à une gestion de la douleur, permet également de réduire les risques de complications tels que les infections ou les thromboses.